La dynamique politique à l’œuvre est une forme de persistance des pratiques politiques qui, au lieu d’une rupture, marquent une certaine continuité du système de gouvernance.
Depuis les indépendances, la multiplication des coups d’État en Afrique s’est quasi-systématiquement justifiée par le désir des militaires putschistes de changer la situation de leurs pays. Le coup d’État du 18 août, au Mali, s’inscrivait dans une démarche similaire. Les putschistes, réunis au sein du Comité national pour le salut du peuple (CNSP), se présentaient en tant que garants de la cohésion de la société, et arbitre s’autorisant à intervenir contre un régime qui ne satisfait plus la population.
Dès leur premier discours télévisé, dans la nuit du 18 au 19 août, les putschistes énumérèrent toutes les revendications du Mouvement du 5 juin-Rassemblement des forces patriotiques (M5-RFP) : contestations des résultats des élections législatives de mars-avril 2020, insécurité grandissante, clientélisme politique, gestion familiale de l’État, détournement des deniers publics, corruption de la justice, crise de l’école, mauvaise gouvernance. « C’est au vu de tout cela que nous avons décidé de prendre nos responsabilités devant le peuple afin d’éviter au pays de sombrer », expliquaient-ils alors.
De ce fait, il est naturellement attendu que les transitions mises en place par les putschistes permettent, en pratique, une véritable remise en cause du régime déchu. Mais force est de constater que ces transitions peuvent aussi demeurer sous le contrôle des dirigeants en place. Le cas malien semble, à bien des égards, s’inscrire dans cette seconde logique.
Le coup d’État du 22 mars 2012 n’avait permis ni un renouvellement de la classe politique, ni un changement dans le système dénoncé encore moins dans le mode de gouvernance. Cinq mois après le coup d’État d’août 2020 contre le régime d’Ibrahim Boubacar Keïta, dit « IBK », très peu (ou pas) d’éléments sont venus véritablement conforter l’idée d’une volonté réelle de rompre avec le régime de ce dernier et le système de gouvernance existant.
Un processus d’extirpation et de constitution
Par définition, le coup d’État marque un moment de rupture de l’ordre constitutionnel, de même que la transition devrait constituer un moment de changement et d’ouverture. Les transitions représentent, ainsi, la résultante de deux processus combinés : « l’extirpation » et la « constitution ».
L’extirpation consiste à sortir du précédent régime, tandis que la constitution a pour fonction d’asseoir le nouveau régime. Le rôle fondamental de l’armée, durant la transition, est davantage précisé par Adam Przeworski qui explique que « partout où l’armée reste un acteur cohérent et autonome, les éléments d’extirpation dominent le processus de transition ».
La volonté de « changement » apparaît, à plusieurs égards, comme un simple slogan dépourvu de substance réelle. La dynamique politique que l’on constate, depuis le début de la transition, est plutôt une forme de persistance des pratiques politiques clientélistes, de transhumance politique au gré des intérêts individuels, de cooptation et une course effrénée aux postes politiques de la part des militaires. La mise en place du Conseil national de transition (CNT) est assez illustrative de ce constat.
Boycott des forces politiques
Le 10 novembre 2020, la vice-présidence de la transition a publié un décret relatif à la mise en place du CNT avec la clé d’attribution des quotas dédiés aux différents groupes politiques, syndicaux, de la société civile, etc. Qui plus est, le décret précisait que le colonel Assimi Goita « après examen des dossiers, arrête la liste des membres du Conseil national de la transition […] ». Notons que la charte de la transition précise les prérogatives du vice-président, qui est exclusivement chargé des questions de sécurité et de défense. On peut, dès lors, se demander en quoi la composition de cet organe relève d’une question de défense ou de sécurité.
En raison non seulement du nombre de sièges qui leur était attribué en comparaison au nombre dédié aux militaires, mais aussi du procédé du choix de leurs représentants, plusieurs forces politiques ont décliné leur participation au CNT. Le CNT a pourtant été mis en place le 3 décembre. Le colonel Malick Diaw, unique candidat, a été élu président avec 111 voix et 7 abstentions sur un total de 118 votants.
Les 3 voix manquantes sont celles des représentants des mouvements signataires de l’Accord. La Plateforme a publiquement dénoncé le non-respect des engagements convenus avec les autorités de transition autour de la mise en place du CNT. La Coordination des mouvements de l’Azawad (CMA) a, quant à elle, dans une déclaration publique, dénoncé le processus de désignation des membres du CNT, en indiquant « surseoir purement et simplement sa participation au processus de mise en place du CNT jusqu’au rétablissement de la confiance et du compromis ».
Constats
Plusieurs constats peuvent être faits de la mise en place du CNT. Le premier est que des membres ou ex-membres de certaines forces politiques ayant boycotté l’organe législatif ont été cooptés par le pouvoir. Un autre constat est l’opacité totale qui a entouré la composition même du CNT. Hormis quelques personnalités connues, on ignore la grande majorité de ses membres, qu’on soupçonne toutefois d’être des militaires.
Le procédé, tout sauf fortuit, consisterait d’ailleurs à brouiller les pistes, les multiples nominations des militaires à des postes politiques ayant suscité des débats au sein de l’opinion publique malienne. Précisons ici qu’un militaire est seulement reconnu à travers l’attribut militaire qui accompagne son nom. La liste du CNT, publiée le 3 décembre 2020, ne précise la fonction d’aucun de ses membres, mais se contente d’indiquer seulement leurs noms et prénoms.
L’intérêt pour la junte de mettre sous influence le CNT (ce qu’elle est aisément parvenue à faire) est d’autant plus grand que cet organe est doté des prérogatives de l’Assemblée nationale. Il aura la charge de voter les textes relatifs aux différentes réformes prévues durant la transition, et détient également le pouvoir d’opérer une révision de la charte de la transition.
Cet article est publié dans le cadre du partenariat avec Open Society Initiative for West Africa (OSIWA).
- Boubacar Haidara est chercheur associé au laboratoire Les Afriques dans le Monde (LAM), Sciences-Po Bordeaux / Chargé de cours, Université de Ségou (Mali), Université Bordeaux Montaigne.
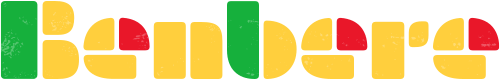

R s i one