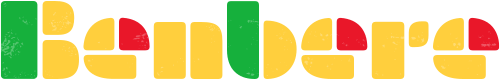Malgré les mesures édictées par les autorités sanitaires, les personnes qui font la récupération des déchets dans les rues et les dépôts d’ordures continuent leurs activités, sans la moindre protection, en cette période de pandémie du Covid-19.
Il est environ 11h. Un soleil de plomb s’abat sur le Rail-Da (Avenue Al qods). À l’arrêt de Sotrama, le ronronnement des moteurs se mêle aux appels des apprentis en quête de potentiels passagers. Non loin de là, deux grosses caisses remplies de déchets à l’effigie de la société Ozone sont prises d’assaut par des femmes et des adolescents venus « faire la poubelle ».
Avec des bâtons, des pelles, ils remuent sans cesse les ordures à la recherche de matières valorisables abandonnées par les citadins et qu’ils pourront vendre : vieux habits, matériels électroménagers, déchets plastiques, chargeurs pour téléphones et ordinateurs usagés. Qui sait quelles autres étranges choses pourrait-on extraire de ces déchets ?
Exposés à la maladie
D’où proviennent tous ces déchets ? La réponse de Marie Koné, qui fait de la récupération informelle des déchets, est vague : « On les ramasse partout. On ignore la provenance ». De quoi susciter notre inquiétude dans un contexte marqué par la progression de la pandémie de coronavirus. Sans masques encore moins de gants, ces récupérateurs manipulent des déchets dont ils ignorent la provenance. Une odeur fétide se dégage. Leur degré d’exposition semble très élevé.
Aminata B. est veuve et mère de deux enfants. Teint clair, lèvres tatouées, la voix gaillarde, elle fulmine lorsqu’on l’interroge sur les bénéfices qu’elle tire de cette activité. Elle avoue que ce travail tue à petit feu. Aminata B. est convaincue que les exhalaisons désagréables qui émanent des déchets ne sont pas bonnes pour la santé. Le vieux Kalifa, avec qui elle sondait les déchets avant de mourir, a développé une toux grave : « Moi et les autres, nous sommes condamnés à souffrir quotidiennement dans ces ordures qui ne feront que détériorer notre santé. Beaucoup de journalistes sont passés ici, mais après rien ne change. À la longue, on va troquer nos informations contre de l’argent », lance-t-elle avec un sourire avant de se replonger dans les déchets.
Sur la question liée à la contamination facile par le coronavirus, elle se relève pour donner une réponse un rien fataliste : « L’être humain ne peut pas échapper à son destin. Seul Dieu peut nous sauver. On ne peut pas arrêter ce travail. On ne vit que de ça », martèle-t-elle.
Quant à Kani Cissé, aussi présente sur les lieux, elle se distingue par sa volubilité et la haine qu’elle voue à l’inaction. Elle confie que si elle avait le choix, au grand jamais elle ne dépendrait de ce que jettent les autres. « Il y a toutes sortes de saletés dans ces ordures. À la longue, vous risquerez de tomber malade », ajoute-t-elle.
S’exposer pour survivre
Fière de l’éducation qu’elle dit avoir reçue de son père, Aminata B. refuse de tendre la main : « Je remercie Dieu. Je n’ai pas des millions, mais avec le peu que je gagne dans ça, je parviens à payer mon loyer à Sabalibougou. » Par ailleurs, ces femmes et enfants, après avoir ramassé une quantité importante de déchets, le cèdent à des prix qu’ils jugent « dérisoires ». Chez le jeune Amadou, récupérateur de déchets, c’est un autre son de cloche. À la différence des autres femmes, il se réjouit de ce travail : « Chaque jour, je gagne au moins deux mille francs », lance-t-il
Les autorités sanitaires doivent se pencher sur la situation de ces femmes, hommes et adolescents qui vivent de ces déchets. Cela ne doit plus tarder, parce que chaque jour la pandémie progresse avec son lot de nouveaux cas positifs. Une campagne de sensibilisation serait salutaire à destination des personnes pratiquant cette activité.