Peu connu de la nouvelle génération, Aguibou Dembélé fait pourtant partie des pionniers du théâtre malien. Ce natif de Kirango Markala, dans la région de Ségou, du haut de ses 70 ans, transmet aujourd’hui son savoir-faire au Conservatoire des arts et métiers multimédia Balla Fasseké Kouyaté de Bamako et à l’Institut universitaire de technologie (IUT). C’est à son domicile, en plein cœur de Bamako, qu’il a bien voulu accueillir Benbere pour un entretien sur le théâtre au Mali.
Benbere : C’est quand la dernière fois que vous avez joué ?
Aguibou Dembélé : La dernière fois que j’ai joué remonte à l’inauguration du palais de la culture de Bamako. Je ne me souviens même plus de la date (rires).
Peut-on dire que le théâtre malien, en même temps que votre promotion, a déserté la scène ?
Je ne dirais pas que le théâtre a déserté la scène, mais les changements sont remarquables. Le problème est que depuis un certain temps le théâtre a arrêté d’être soutenu. Aussi, beaucoup de jeunes viennent dans le domaine pour paraître et non par passion. On ne devient pourtant pas du jour au lendemain comédien parce qu’on fait rire deux ou trois amis du quartier. Nous avons aujourd’hui plus de comédiens qui s’aiment dans l’art que de comédiens qui aiment l’art en soi.
Quelle est la différence entre ces deux catégories de comédiens ?
Nous, nous aimons l’art. C’est une passion. D’autres s’aiment dans l’art, parce qu’il y a des honneurs, beaucoup d’argent. Tout ceci a beaucoup impacté négativement le théâtre où le premier souci des acteurs est de faire du profit.
Parmi les nouveaux acteurs, beaucoup n’arrêtent pourtant pas de décrier le manque de soutien. Pourquoi, selon-vous ?
C’est un problème qui date de la chute de Moussa Traoré. Nous en avons également souffert avec le groupe d’art dramatique national. On jouait dans des conditions difficiles vers les années 1970, mais cela n’a pas freiné notre passion. Je continue à partager avec tous les jeunes qui veulent apprendre. Ces jeunes-là ont de la force. Si la passion est là, c’est le plus important.
Pouvez-vous nous parler un peu de ces difficultés des années 1970 ?
Pendant certaines de nos tournées, les ânes étaient chassés des cases, qui étaient ensuite nettoyées pour nous accueillir. On pouvait faire 15 jours de tournée sans percevoir un centime, si ce n’est la nourriture qu’on nous donnait.
Que reste-t-il du groupe d’art dramatique national que vous avez d’ailleurs dirigé ?
Du groupe d’art dramatique, il ne reste que le nom malheureusement. Une compagnie qui ne produit pas n’est plus vraiment une compagnie.
Même sans soutien n’aurait-il pas pu continuer à monter des pièces, si on part du principe qu’avoir de la passion c’est déjà beaucoup ?
Nous avons tout donné jusqu’à l’épuisement. D’autres en sont morts. Je pense particulièrement à mes amis Racine Dia et Mamoutou Sanogo. Par devoir de transmission, nous avons partagé et continuons à le faire. La majorité des comédiens connus aujourd’hui, comme Habib Dembélé, sont nos élèves et c’est une fierté pour moi. La machine n’a, malheureusement, pas pu continuer à notre départ. Même si la passion suffit, le passionné a besoin d’être entretenu.
Quand vous débutiez, on parlait plutôt de Kotèba. Ce théâtre existe-il encore ?
Je dirais plutôt qu’il est agonisant. C’est vrai qu’on nous appelait Kotèba, car les populations, lorsqu’on jouait, voyaient dans notre jeu ce théâtre traditionnel très satirique qui existait déjà dans la société du Mali d’hier. Il rode encore, mais il n’est pas très considéré. Les gens préfèrent plutôt Yèlèbougou.
Les gens ne doivent pas s’intéresser à Yèlèbougou, selon-vous ?
Chacun est libre de s’intéresser à ce qu’il veut. Mais quand ce n’est pas du théâtre, il faut aussi le dire. C’est l’amalgame qui me dérange. Je ne conçois pas le fait qu’on puisse attribuer le titre de comédien à des personnes qui sont incapables de te parler ne serait-ce que des différentes fonctions du rire.
Pour voir du théâtre, il faut débourser au minimum 3 000 francs CFA, sinon 5000 ou même 10 000 francs CFA des fois. Le Malien vit pourtant avec moins de 500 francs par jour. En tenant compte de cette réalité, ne peut-on pas dire que le théâtre est un luxe ?
Le théâtre en salle est un concept qu’on ne connaissait pas. C’est importé. Vers les années 1975, dans la salle Omnisports, nous avons monté et joué Kaïdara d’Amadou Hampâté Bâ, un spectacle de 2h30 qui a couté des millions. Mais le succès n’a pas suivi, parce que c’était monté avec des codes européens. Ce sont les occidentaux qui font ce que nos autorités refusent de faire pour la culture. Ils imposent donc leurs manières de faire. Le théâtre malien ne répond pas aux aspirations des Maliens en plus d’être cher pour eux.
Faut-il donc revenir à la forme traditionnelle ?
Il faudrait plus de création en langues vernaculaires et un réel soutient des autorités. A la suite de Kaïdara, nous avons commencé à faire le Kotèba. Le succès a été immédiat. On avait parfois du mal à se frayer un chemin pour regagner la scène tellement le terrain de basket de l’Omnisports se remplissait à chaque représentation. Jusqu’au renversement de Moussa Traoré, le public venait nous voir chaque deux jours.
C’est la deuxième fois que vous parlez de Moussa Traoré. Vous avez dit que le manque de soutien au théâtre date de sa chute. Sous son régime, le théâtre était une priorité ?
En 1970, sous Moussa Traoré, on avait déjà à Omnisports une régie son et lumière très professionnelle. Aujourd’hui, ça n’existe pas. Le théâtre était subventionné par l’État à différents niveaux : cercles, communes, etc. C’était obligatoire.
Vous n’êtes donc pas de ceux qui ne gardent que le souvenir d’un régime autoritaire…
Je suis un homme de théâtre et j’ai juste remarqué que sous Moussa Traoré, cet art était plus valorisé que sous aucun autre régime. Le dire est un devoir. Moussa Traoré venait nous voir chaque fois qu’on jouait. Malgré que les propos étaient durs contre son régime, il en riait aux éclats. Nous avons été les premiers à critiquer sévèrement le régime militaire lors de la Biennale artistique de 1980. On était presque certains qu’on irait tous en prison après le spectacle. Mais, à notre grande surprise, Moussa Traoré a ri.
C’était pas comme pour vous dire, si vous permettez, « les chiens aboient la caravane passe »… ?
Pas du tout. Il nous remerciait ensuite, car il savait qu’on lui disait des choses que ses proches collaborateurs ne faisaient pas. Et grâce à nos pièces, il ne badinait pas avec la rigueur au niveau de l’administration. La dictature a encouragé les critiques du théâtre contrairement à la démocratie. Cette démocratie tant souhaitée a muselé le théâtre malien.
Comment la démocratie a-t-elle muselé le théâtre malien ?
Quand Alpha Oumar Konaré était au ministère de la Jeunesse, des Sports, des Arts et de la Culture, sous Moussa Traoré, il nous a une fois remis 2 millions pour qu’on continue les recherches sur le Kotèba en nous exprimant son intérêt pour le théâtre malien. Qu’est-ce qui l’a empêché de concrétiser cet intérêt lorsqu’il est devenu président ?
Vous en voulez donc à Alpha Oumar Konaré ?
Je suis en tout cas certain qu’il pouvait faire mieux que Moussa Traoré.
Si l’on devait repartir sur de nouvelles bases pour que le théâtre malien se porte mieux, que proposeriez-vous ?
Déjà, je trouve que la nouvelle ministre de la Culture, de l’Artisanat et du Tourisme, Dramé Kadiatou Konaré, est en train de faire un travail extraordinaire avec sa série de séminaires sur tous les arts au Mali. Une première dans ce pays. Tous les problèmes de l’art ont été identifiés et les solutions à tous les niveaux ont été proposées. Ce document, s’il est exploité après la transition, fera décoller les arts au Mali.
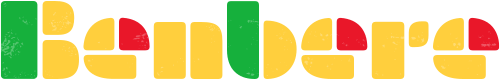

Très intéressant