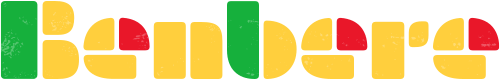Pour le blogueur Abdoulaye Traoré, la société malienne s’enfonce dans les dédales d’un matérialisme qui, outre qu’il détermine les relations interpersonnelles, a conduit à ce qu’il appelle « une marchandisation des rapports entre parents et enfants » qui a des conséquences dramatiques.
Dans un monde où l’enjeu d’un nouvel ordre s’intéresse à la préservation de l’humanité dans une approche de développement durable, le Mali est à la traîne et peine à trouver sa voie, son identité, son modèle. La société malienne contemporaine semble alors se caractériser, à l’image de celles occidentales, par le souci de consommation. Même si nous ne saurions convoquer ici la psychologie clinique de l’acheteur convulsif, il s’agit, toutefois, d’un besoin général de posséder afin de paraître riche et nanti aux yeux des autres. Ce qui a conduit à de profondes transformations, tant dans les habitudes quotidiennes que dans le domaine moral et éthique.
Parlant de signification, le matérialisme ordinaire semble rester essentiellement centré sur les rapports de possessions matérielles. Toutefois, il convient de distinguer ce type de matérialisme de celui éthique. Il s’agit, tout simplement, de penser le sens que le commun des Maliens parait conférer aux biens matériels ou gadgets : maisons luxueuses, voitures, vêtements de marques, téléphones, ordinateurs, bijoux, entre autres. Des signes extérieurs de richesses qu’il faut coûte que coûte détenir afin d’éviter le ridicule en public.
Un jeune interlocuteur de Sotuba, quartier populaire de Bamako, résumera la situation ainsi : « Évitez que les autres ne vous prennent en pitié ». Être pris en pitié suppose être considéré comme pauvre. Dans un pays sous-développé, l’élément de valeur est celui qui possède. Or, dans ceux industrialisés, c’est plutôt celui qui a un fort pouvoir d’achat. Il ne semble pas y avoir de différence capitale, dans la mesure où dans l’un ou l’autre des cas, celui qui possède, c’est celui qui détient une capacité d’acquisition.
Jeu du paraître riche
Ce qui pose la question du matérialisme ordinaire en terme universel, un comportement que l’humanité semble avoir en commun. Cependant, ce qui peut faire la différence serait plutôt le rapport que nous avons face à la possession et les enjeux individuels et même communautaires qui en découlent. En effet, il ne s’agit plus de voir, dans notre société, le bien matériel comme source de bien-être comme chez les occidentaux. Ces derniers, dès lors qu’ils consomment ou cherchent à posséder, visent l’amélioration de leur confort quotidien. Par exemple, acheter une monospace pour une famille nombreuse, un téléviseur LCD pour avoir une meilleure définition de l’image, un ordinateur MacBook pour ses options de traitements de données et de sécurité pour les usagers quotidiens, etc.. Un comportement rationnel et motivé.
Par contre, dans les sociétés sous-développées, la consommation ou le souci de possession viserait plutôt l’amélioration du regard social sur soi. C’est un moyen de monter dans l’échelle sociale et de prouver aux autres que l’on a réussi sa vie, que l’on est digne d’estime. En effet, tout porterait à croire que ce souci de possession participerait aux éléments qui semblent structurer l’identité sociale de l’individu.
En guise d’illustration, on parlera, s’adressant à un individu reconnu pour détenir de belles choses, « djoba, Maitri ou président » … L’individu semble alors se faire reconnaître par la qualité et, mieux, le coût des biens qu’il détient et devra, ad vitam aeternam, exceller à ce jeu du paraître riche. Sinon, tout son prestige et sa reconnaissance sociale s’effondreront comme un château de cartes. En ce sens, la possession devient une sorte « d’extension du soi ». Il devient un signe de reconnaissance et de distinction. Et, en fin de compte, on peut dire des individus qualifiés de « matérialistes », qu’ils sont très investis dans ce que leur offre la société de consommation et semblent même y trouver un moyen de réalisation sociale.
Marchandisation des rapports
Tout cela pose souvent, dans notre société des problèmes d’ordre moral. C’est comme si, des parents maliens « contraignent » leurs enfants à réussir, par tous les moyens, afin qu’ils leur fassent honneur aux yeux de la société. Ils attendent d’eux, qu’ils leur rendent tout ce qu’ils ont fait pour eux, qu’ils paient pour tous les sacrifices auxquels ils ont consenti durant leur éducation.
C’est, en effet, une marchandisation des rapports parents/enfants qui se pose et devient, par la suite, le moteur de définition des positions au sein de la famille et du quartier pour se faire le titre de « douwaou dein », enfant prodige ou béni. Et plus tôt, on s’acquittera de sa dette et plus élevée sera notre position au sein de la fratrie et de la société. Quitte à devenir l’aîné social de ses aînés en âge, car on aura réussi à payer sa dette bien avant eux.
C’est le cas de Madou Konaré, un médecin qui trouve que ses parents le respectent plus que ses grands frères : « Une situation qui, parfois, me met mal à l’aise car je trouve que peu importe la situation de mes aînés, ils ont droits à plus de considération et de respect que moi. »
Une Maladie dans la société malienne
Dans le cas contraire, celui qui porte le visage du loser, « danga dein », qui n’a pas réussi comme ses pairs et qui ne veut pas faire d’effort pour payer sa dette envers ses parents, sera honni de tous. En société, sa parole ne comptera pas, son existence insignifiante : il passera derrière les femmes et les enfants. Il est tout simplement le « fari langolon ou horon kolon », celui qui n’a pas d’honneur, encore moins de vergogne. Rappelons que l’honneur et la vergogne se mesurent, dans cette société, à travers la sécurité que les autres ressentent envers celui qui, en cas de besoin, serait capable de leur venir en aide par son capital financier.
L’autre qui n’a rien est plutôt vu comme une charge, un parasite qu’il faut éliminer. Dès lors, s’établit une sorte d’« eugénisme financier » avec des conséquences dramatiques qui conduisent un jeune à emprunter des embarcations de fortune pour atteindre les côtes européennes dans la quête d’un avenir radieux, au péril de sa vie. « Prendre ce risque de traverser la méditerranée est ma dernière option car j’ai aussi besoin d’exister, je veux qu’on me respecte, je veux que mes parents soient fier de moi, je veux payer ma dette envers eux », affirme Abdoul, qui est prêt à se rendre en Europe, persuadé que là-bas il s’en sortira.