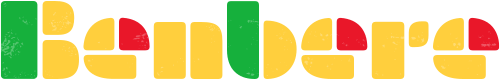Dans son adresse à la nation, le 14 avril 2019, le président malien Ibrahim Boubacar Kéita a annoncé la tenue d’un dialogue national sur le projet de réforme de la Constitution. Les récents évènements politiques semblent avoir renvoyé l’initiative aux calendes grecques. Ousmane Sy, promoteur du Centre d’expertises politique et institutionnelle en Afrique, nous livre son analyse de la situation.
Benbere : Vous écriviez dans un article sur votre blog, que le dialogue national ne doit plus être une concertation à Bamako. Quel contour faudrait-il donner à un tel exercice ?
Ousmane Sy : Je dis sans cesse que nous devons nous engager dans un processus de dialogue. Le dialogue, il y a deux façons de le tenir. La première, c’est de faire un dialogue-évènement. J’entends par dialogue-évènement le fait de réunir 1500 personnes dans une salle, se batailler, discuter pendant trois jours, une semaine, quinze jours et sortir en se disant qu’on a écouté les gens. La deuxième, c’est la conférence d’entente nationale. Avant, il y a eu la Conférence nationale, après les évènements de mars 91. Des représentants de toutes les parties du pays ont été appelés. Cela a été un dialogue-évènement. Peut-être qu’à l’époque, cela correspondait à un dialogue…
Aujourd’hui, quel type de dialogue pour faire face aux nombreux défis qui se posent au pays ?
Le dialogue que je prône depuis plusieurs mois, c’est le dialogue-processus. Le Mali est un pays d’une grande diversité aussi humaine que géographique. En ces moments de crise où l’on est en train d’assister à la désunion du pays, il faut donner la possibilité d’aller entendre et d’écouter toute la diversité si on engage le dialogue. Cela veut dire qu’il faut que ce dialogue parte de la base du pays, des villages sinon des communes pour remonter. Les concertations citoyennes se feraient peut-être dans chaque commune où il y aurait des représentants de chaque village. On ferait des synthèses aux niveaux cercle, région pour finir par une synthèse au niveau national. A ce moment là, on aura écouté toute la diversité malienne : diversité des territoires, diversité des groupes humains. On pourra dire qu’on a organisé un dialogue, donné la possibilité à tous les Maliens de pouvoir s’exprimer, donner leur point de vue. Il faut préparer ce dialogue au plan technique, politique. Donc, un dialogue qu’on ne peut pas bâcler en trois mois. Il faut prendre le temps de le faire. Il nécessite une médiation, parce que n’importe qui ne peut pas conduire un dialogue où il faut arriver à faire parler toutes les parties, à se mettre d’accord sur quelque chose.
Faudrait-il ouvrir ce dialogue, même aux acteurs armés terroristes comme Kouffa et Iyad, comme l’a recommandé la conférence d’entente nationale ?
Pourquoi pas ? On a dit dialogue inclusif. Personne ne doit être exclu, surtout qu’on le fait sur le territoire. Comment voulez-vous qu’on aille organiser aujourd’hui un dialogue dans une région comme Mopti, à Youwarou, Djenné, Teninkou et dire que les gens de Hamadoun Kouffa n’y prendront pas part ? Ils sont là-bas, viendront prendre la parole, défendre leur point de vue. C’est une façon justement pour un pays de donner la parole à toutes ses composantes. Pour moi, si on veut réussir ce dialogue, il ne faut pas rentrer dans la logique d’exclusion. Il faut faire un dialogue ouvert. S’ils ne veulent pas prendre la parole à Bamako, qu’ils le fassent à Youwarou et qu’on les écoute.
La situation sécuritaire est-elle favorable à un dialogue inclusif ?
Oui. Je vais vous surprendre. Il y a dix jours, j’étais à Bandiagara. Quand il y a eu le prétendu affrontement entre Peuls et Dogon, nous avons organisé une grande rencontre avec les élus, les personnes ressources, toutes les grandes organisations de la société civile locale. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il s’est passé quelque chose d’extraordinaire. Il y a une association de forgerons qui est venue sans être invitée. Ils ont pris la parole et dit qu’en tant que forgerons, ils peuvent aller là où l’armée, l’administration ne peuvent pas. Ils peuvent aller parler aux gens. Donc, on a des mécanismes qui existent dans notre société, qui peuvent nous être utiles aujourd’hui. Là où l’armée, l’administration ne peuvent pas aller, il y a des gens qui peuvent y aller.
Dans vos travaux, vous remettez également en cause le modèle d’Etat du Mali. Quel type d’Etat sied-il le mieux aux préoccupations du moment ?
Je suis reconnu au Mali aujourd’hui comme le « père de la décentralisation ». Je suis entré dans la décentralisation par conviction. J’ai compris très vite, pour avoir travaillé comme chercheur en milieu rural, qu’il y avait un décalage entre l’Etat et les communautés. Et tant qu’on ne résoudra pas ce problème, on n’aura pas un pays apaisé, stable et en condition de développement.
Notre Etat est une production de l’Etat colonial. Depuis l’indépendance, on n’a pas pu résoudre ce problème. Je crois que la grosse contrainte du pays, aujourd’hui, ce ne sont pas les communautés. Même dans la région de Mopti, je le dis et je le défends, le problème n’est pas Hamadoun Kouffa. De quoi se plaignent les communautés ? Elles se plaignent des préfets, des juges, des gendarmes, des agents des eaux et forêts. Ce sont ces corps-là qui ont créé le terrain favorable à Hamadoun Kouffa.
II faut que cela change, parce qu’avant les gens le supportaient faute de recours mais ils supporteront de moins en moins parce que la population rajeunit. La population jeune, aujourd’hui, est beaucoup moins docile que la population ancienne. Elle a plus de droits, est mieux informée et en est consciente. Avant, une information pouvait prendre beaucoup de temps pour atteindre les villages. Aujourd’hui, c’est instantané. Toutes ces mutations se sont opérées mais l’Etat n’a pas bougé. L’Etat est resté le même, à la limite un Etat colonial.
Après vingt ans de décentralisation, les administrateurs continuent toujours de se comporter en « commandant ». Je crois que c’est cela le problème. Il faut faire évoluer l’Etat. Aujourd’hui, on veut faciliter le retour de l’Etat, tout le monde en parle. Mais les populations n’ont rejeté l’Etat que dans sa forme. Maintenant, est-ce que nous avons la capacité aujourd’hui de réfléchir et de concevoir un Etat adapté à ce que les populations demandent ? Si nous ne faisons pas cela, l’Etat va finir par disparaitre.
Vous n’avez pas besoin d’aller dans les villages. Mettez-vous dans les rues de Bamako, sur les carrefours pour regarder. Est-ce qu’il y a un Etat ? Chacun fait ce qu’il veut. L’Etat gère l’espace public. L’espace public est devenu une jungle aujourd’hui. La circulation symbolise cet état de fait. Les policiers qui sont là pour réguler au nom de l’Etat sont plus préoccupés par leurs intérêts personnels que l’intérêt collectif. Donc, pour moi ce type d’Etat est au cœur de nos problèmes. Et aussi longtemps qu’on ne s’occupera pas de lui, le faire évoluer pour correspondre à ce que les gens attendent, nous ne sortirons pas de la crise. Et ce n’est pas avec l’armée qu’on va régler ce problème.